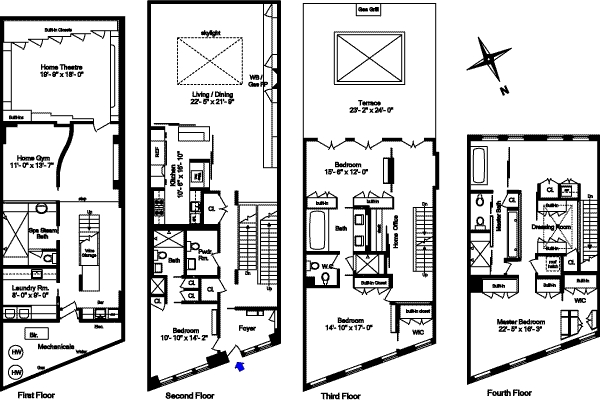Je suis un «rescapé» du 11 septembre 2001. Enfin, j’exagère.
J’ai quitté New York le soir du 1er septembre de cette année-là. Je venais de vivre douze années aux Etats-Unis, dont dix à 1500 mètres du World Trade Center. Le 1er septembre, c'était un samedi. Le matin de ce jour-là, je suis allé prendre mon petit déjeuner au "Starbucks" du World Financial Center, des immeubles de bureaux qui font partie du complexe du World Trade Center. Mon dernier petit déjeuner de résident à New York... Après avoir bu mon "espresso doppio" et avalé mes muffins, je suis passé à pied entre les deux tours jumelles, le "New York Times" sous le bras. Il était environ 8 heures du matin. Le temps était splendide. Dix jours plus tard, au même endroit à la même heure, le mardi 11 septembre, il faisait également très beau. Le ciel s'est vite obscurci, à 8h46, mais pas pour des raisons météorologiques.
J’ai quitté New York le soir du 1er septembre de cette année-là. Je venais de vivre douze années aux Etats-Unis, dont dix à 1500 mètres du World Trade Center. Le 1er septembre, c'était un samedi. Le matin de ce jour-là, je suis allé prendre mon petit déjeuner au "Starbucks" du World Financial Center, des immeubles de bureaux qui font partie du complexe du World Trade Center. Mon dernier petit déjeuner de résident à New York... Après avoir bu mon "espresso doppio" et avalé mes muffins, je suis passé à pied entre les deux tours jumelles, le "New York Times" sous le bras. Il était environ 8 heures du matin. Le temps était splendide. Dix jours plus tard, au même endroit à la même heure, le mardi 11 septembre, il faisait également très beau. Le ciel s'est vite obscurci, à 8h46, mais pas pour des raisons météorologiques.
 Dix ans après cette date fatidique, je souhaiterais davantage de modération dans la commémoration médiatique qui s’ébauche en France et qui fonctionne de manière frénétique de l’autre côté de l’Atlantique, d’après les amis avec qui je suis en contact là-bas. Petit rappel : un anniversaire n’est pas une information. Les journalistes moutonniers l’oublient toujours.
Dix ans après cette date fatidique, je souhaiterais davantage de modération dans la commémoration médiatique qui s’ébauche en France et qui fonctionne de manière frénétique de l’autre côté de l’Atlantique, d’après les amis avec qui je suis en contact là-bas. Petit rappel : un anniversaire n’est pas une information. Les journalistes moutonniers l’oublient toujours.Je ne nie pas l'horreur de l'événement et ses nombreuses conséquences pour des milliers d'individus et leurs familles. Je mesure le choc ressenti par les New Yorkais et les Américains en général, même une décennie plus tard.
J'aime profondément ce pays. Mon premier voyage remonte à 1969. J'avais 16 ans. Ce voyage a marqué ma vie et la marque encore.
Mais il faut aussi que les Américains apprennent à prendre du recul, à relativiser, à considérer ce qui se passe ailleurs.
La guerre en Irak, voulue par un président élu et réélu, est une faute lourde, cautionnée par un pays démocratique et ses institutions, avec l'assentiment tacite ou exprimé de presque tous les médias, y compris les plus intelligents. Cette guerre a fait des milliers de morts, dans tous les camps, sous des prétextes infondés : Saddam Hussein ne possédait pas d’armes de destruction massive et son pays n’était pas une base d’Al-Qaida.
 Je pourrais aussi évoquer le Vietnam, pays que j'ai découvert il y a peu et qui a énormément souffert de la guerre lancée (et perdue) par les Etats-Unis, toujours au nom de la démocratie. Le napalm, les massacres, ce n’était pas une plaisanterie. L'origine de ce conflit asiatique remontait, il est vrai, aux errances coupables du colonialisme français...
Je pourrais aussi évoquer le Vietnam, pays que j'ai découvert il y a peu et qui a énormément souffert de la guerre lancée (et perdue) par les Etats-Unis, toujours au nom de la démocratie. Le napalm, les massacres, ce n’était pas une plaisanterie. L'origine de ce conflit asiatique remontait, il est vrai, aux errances coupables du colonialisme français... Le 11 septembre 2001 n'est pas la pire tragédie ou le tournant le plus décisif de l’Histoire contemporaine ni même de ce siècle encore tout jeune. Il y en aura d'autres. La catastrophe de Fukushima pourrait ou devrait avoir des conséquences plus profondes sur notre manière de consommer, de produire de l’énergie, de vivre en accord avec notre environnement et de faire de la politique. C’est du moins ce que l’on peut espérer. Mais ceci est une autre histoire.
Je critique suffisamment les Français qui ne voient le monde que par le petit bout de leur lorgnette embuée. Les Américains ont aussi parfois la vue basse en oubliant les carnages du passé.
Et pourtant, dans leur courte Histoire, les Etats-Unis ont traversé des bains de sang bien plus effroyables. La guerre de Sécession (Civil War) avec ses plus de 600.000 morts a été plus meurtrière que la Seconde Guerre Mondiale pour l'ensemble des troupes américaines engagées sur tous les fronts de ce conflit. Il ne s'agit pas d'établir un palmarès des hécatombes. Ce n'est pas un macabre concours.
Le choc du 11 septembre, contrairement à ce qu’on a dit à l’époque, n’a pas fondamentalement modifié les habitudes et les comportements des Américains. C’est un événement tragique et ponctuel. C’est seulement un épisode de l’histoire américaine et du monde. Ce n’est pas un événement fondateur.
Le 11 septembre s’inscrit dans un processus historique beaucoup plus large : la chute du communisme qui a mis fin à la politique des blocs issue de la Guerre Froide, favorisant la montée du fondamentalisme islamiste avec ses avatars extrêmes du terrorisme.
Le 11 septembre n’est pas, à mes yeux, une date clé comme le voyage de Christophe Colomb suivi du peuplement de l’Amérique par les Européens, l’invention de l’imprimerie ou du moteur à explosion, l’arrivée d’Hitler au pouvoir ou la chute du mur de Berlin.
Ce que les hommes de Ben Laden ont réalisé avec une cruelle réussite est un acte sanglant, considéré à juste titre comme odieux par toute personne ayant un minimum de conscience. Mais ce n’est ni le début ni la fin de quoi que se soit. «Plus rien ne sera jamais comme avant», a-t-on dit le 12 septembre 2001. C’est faux.
Les Etats-Unis ont continué sur leur lancée, avec le meilleur et aussi le pire de ce grand pays à la fois généreux et incroyablement injuste : le capitalisme financier fait des ravages, la politique de santé reste bancale, le système éducatif est déficient, la violence gangrène toujours les villes et les campagnes à cause de la prolifération des armes à feu, la peine de mort reste en vigueur, le racisme perdure malgré les acquis des années 60.
Le lieu commun, quand les Etats-Unis sont meurtris ou attaqués, est de dire : "L'Amérique a perdu son innocence". On l'a dit à propos de l'attaque japonaise contre la base de Pearl Harbor en 1941. On l'a répété pour l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas en 1963. L'expression a été ressortie pour le 11 septembre 2001. On ne perd pas son innocence plusieurs fois. C'est comme le pucelage. Aucun pays ne peut être considéré totalement "innocent" ou "coupable". La France a plusieurs taches indélébiles sur ses pages d'Histoire (les guerres napoléoniennes et Vichy, pour ne citer que deux exemples). Les Etats-Unis se sont construits sur deux "péchés originels" : l'éradication presque totale de la population indigène, les tribus indiennes, par les armes, les mauvais traitements, l'alcool et les maladies. Et la pratique de l'esclavage qui n'a pas été une exclusivité américaine.
Mais ce pays, je l’aime pour et malgré ce qu’il est. Et pour ce qu’il est capable de devenir. C’est une nation jeune. Laissons-lui sa chance.
Le lieu commun, quand les Etats-Unis sont meurtris ou attaqués, est de dire : "L'Amérique a perdu son innocence". On l'a dit à propos de l'attaque japonaise contre la base de Pearl Harbor en 1941. On l'a répété pour l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas en 1963. L'expression a été ressortie pour le 11 septembre 2001. On ne perd pas son innocence plusieurs fois. C'est comme le pucelage. Aucun pays ne peut être considéré totalement "innocent" ou "coupable". La France a plusieurs taches indélébiles sur ses pages d'Histoire (les guerres napoléoniennes et Vichy, pour ne citer que deux exemples). Les Etats-Unis se sont construits sur deux "péchés originels" : l'éradication presque totale de la population indigène, les tribus indiennes, par les armes, les mauvais traitements, l'alcool et les maladies. Et la pratique de l'esclavage qui n'a pas été une exclusivité américaine.
Mais ce pays, je l’aime pour et malgré ce qu’il est. Et pour ce qu’il est capable de devenir. C’est une nation jeune. Laissons-lui sa chance.
Un mot encore, car c’est souvent négligé : le 11 septembre 2001 a eu un énorme retentissement grâce à la concentration des médias à New York. Par hypothèse, imaginez la même chose dans une ville d’Afrique, sans caméras disponibles en direct immédiatement ni un fort contingent de journalistes vivant sur place. Nous en aurions beaucoup moins parlé. Aussi parce que, globalement, les Africains, on s’en fout. Et c’est bien regrettable. Pas de journalistes et de caméras en ce moment en Somalie (car c’est matériellement impossible). Circulez, il n’y a rien à voir dans ce pays exsangue et qui crève de faim.
La destruction des tours jumelles a bénéficié d’un énorme effet de loupe à New York car les networks (ABC, NBC, CBS), les chaines d’infos en continu et les stations locales avaient des studios, des équipes, du matériel utilisables sur le champ.
 |
| Le second avion |
Alors que reste-t-il du 11 septembre ? La douleur, le chagrin et le deuil des familles des victimes, évidemment. Le traumatisme des blessés et de tous ceux qui ont vécu sur place ces terribles journées. Il reste aussi le bourbier militaire en Afghanistan, renforcé par la complaisance de l’Occident à l’égard du Pakistan et des monarchies du Golfe. Il reste Guantanamo, pénitencier américain qui échappe à toutes les lois internationales. Il reste également une paranoïa sécuritaire instaurée par l’administration de George W. Bush. Cette obsession antiterroriste n’a pas diminué avec Barack Obama.
Dans ce domaine, Ben Laden a réussi durablement à rendre les voyages en avion très pénibles, avec la multiplication des contrôles et des interdictions plus ou moins baroques. Et si c’était ça, finalement, l'«héritage» («legacy» en anglais) le plus tangible du 11 septembre ?